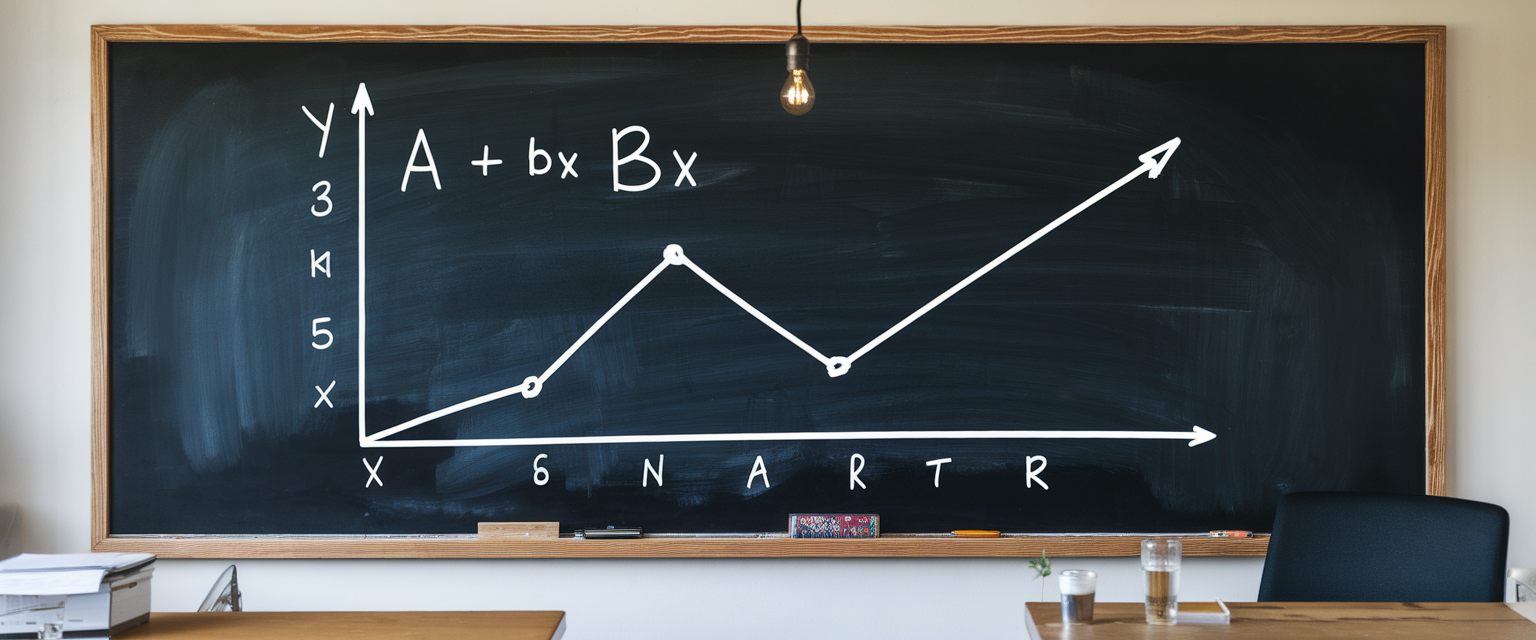| Points clés | Détails à retenir |
|---|---|
| 📈 Evolution de l’inflation et du chômage | 📊 Analyse de la relation entre inflation et chômage à travers la courbe de Phillips |
| ⏳ Historique | 📉 Origine et évolution de la courbe de Phillips depuis les années 1950 |
| 🔍 Facteurs influençant la courbe de Phillips | 💼 Impact des politiques monétaires et budgétaires, du marché du travail et des chocs économiques |
La courbe de Phillips est un outil d’analyse économique permettant de comprendre la relation entre l’inflation et le chômage. Cet article explore l’historique et l’évolution de cette courbe depuis les années 1950, ainsi que les différents facteurs qui influencent son tracé. Nous étudierons également son utilité pour les politiques monétaires et budgétaires, ainsi que pour l’anticipation des chocs économiques. En résumé, cet article vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de la courbe de Phillips et son importance dans l’analyse économique.
01 | Comprendre la courbe de Phillips : une relation macroéconomique fondamentale
La courbe de Phillips, c’est un peu comme une vieille boussole des politiques économiques. Elle illustre une relation inverse entre le taux de chômage et le niveau d’inflation. En d’autres termes, lorsque le chômage diminue, l’inflation a tendance à augmenter, et vice-versa. Ce concept a été introduit en 1958 par l’économiste néo-zélandais Alban William Phillips, à partir de données historiques britanniques couvrant la période 1861-1957. Il avait observé qu’à mesure que le chômage chutait, les salaires grimpaient plus vite, ce qui tendait à nourrir l’inflation.
Aujourd’hui encore, cette relation fait couler beaucoup d’encre. J’ai eu l’occasion, en tant qu’étudiant, de simuler cette courbe durant un projet de macroéconomie appliquée, et elle gardait tout son intérêt pédagogique : simple, visuelle et révélatrice des choix de nos gouvernements.
02 | Origines historiques et évolutions théoriques de la courbe de Phillips
C’est dans l’après-guerre, alors que l’Europe reconstruisait son économie, que la courbe de Phillips a pris de l’ampleur. Les années 1960 ont vu nombre de décideurs politiques s’y fier pour arbitrer entre réduction du chômage et stabilité des prix. Elle semblait offrir un moyen douillet de choisir entre deux maux économiques.
Mais dans les années 1970, tout a basculé. Les chocs pétroliers ont provoqué simultanément une hausse du chômage et de l’inflation : c’est ce qu’on a appelé la stagflation. Milton Friedman et Edmund Phelps y voyaient déjà des failles dans le raisonnement originel. Ils ont théorisé une version à long terme où la courbe devient verticale, soulignant qu’il n’existait pas d’arbitrage durable entre chômage et inflation sans prendre en compte les anticipations des agents économiques.
Personnellement, je trouve fascinante cette bascule historique : elle montre que les outils économiques ne sont jamais définitifs – ils évoluent avec le contexte.
03 | Comment fonctionne réellement la courbe de Phillips ?
La version initiale montre une courbe descendante : plus le chômage est bas, plus l’inflation est forte. Cela s’explique par la pression sur le marché du travail – entreprises et employeurs se battent pour une main-d’œuvre rare, offrant des salaires plus élevés, répercutés par la suite sur les prix.
Mais cette observation, valable à court terme, est remise en cause par la courbe de Phillips augmentée. Elle intègre l’inflation anticipée : selon cette version, les travailleurs demandent des hausses salariales en prévision de l’inflation future. À long terme, l’économie revient vers un taux de chômage dit naturel, qu’on appelle aussi NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), et au-delà duquel toute tentative de réduire le chômage accroît seulement l’inflation.
Je me souviens avoir visualisé cela pour la zone euro sur un graphe de la BCE. Ce qui sautait aux yeux, c’était l’aplatissement progressif de la courbe : la magie de l’arbitrage semblait s’effacer.
04 | Limites et critiques : pourquoi la courbe de Phillips ne fait plus l’unanimité
Soyons honnêtes, la courbe de Phillips a pris un sacré coup de vieux depuis les années 2000. Plusieurs pays développés ont connu des périodes de faible chômage sans explosion inflationniste. Le cas le plus frappant est celui des États-Unis entre 2015 et 2019 : le taux de chômage est descendu sous les 4 %, mais l’inflation est restée sagement en dessous de 2 %. Une anomalie ?
Les économistes avancent plusieurs pistes. D’abord, la montée de l’automatisation et de la mondialisation a amoindri le pouvoir de négociation des travailleurs. Ensuite, la crédibilité accrue des banques centrales a ancré les anticipations d’inflation. Enfin, certains invoquent des rigidités nominales : les prix et salaires ne s’ajustent pas si facilement à court terme.
Pour moi, cette évolution souligne une chose : nos sociétés sont devenues plus complexes, et les modèles économiques doivent s’adapter en permanence plutôt que rester figés dans le passé.
05 | Actualisation récente : la courbe de Phillips à l’ère post-Covid
La pandémie de Covid-19 a laissé une empreinte instructive. En 2020, on a assisté à un effondrement de l’activité, une envolée du chômage… et pourtant, dans certains pays, l’inflation ne bougeait pas. Puis en 2021-2022, le redémarrage a provoqué des tensions sur les chaînes d’approvisionnement, des pénuries, et une inflation soudaine.
Ce phénomène a redonné vie aux débats : la courbe de Phillips existe-t-elle encore ? Selon la BCE, elle est devenue non linéaire : son inclinaison varie selon les phases du cycle. Lorsque le chômage est trop élevé, une baisse supplémentaire a peu d’effet sur l’inflation. Mais lorsque l’économie tourne à plein régime, la relation se resserre brutalement.
En tant qu’économiste amateur, je trouve cette version plus nuancée bien plus réaliste – et intéressante. Car elle invite à ne pas tirer de conclusions hâtives. La politique monétaire, comme un scalpel, doit ajuster ses interventions avec soin.
06 | Applications concrètes et implications pour les politiques économiques
Dans la pratique, les banques centrales se servent toujours de la courbe de Phillips, mais avec prudence. Elle figure dans leurs modèles d’analyse macroéconomique, souvent enrichis, calibrés selon chaque économie. La Fed ou la BCE s’en servent pour estimer les effets des taux d’intérêt sur la pression salariale et l’évolution des prix.
Prenons un exemple récent : en 2022, face à une inflation durablement au-dessus de 5 %, la BCE a commencé à relever ses taux directeurs malgré des craintes sur l’emploi. L’objectif était clair : étouffer la spirale inflationniste, même au prix d’un ralentissement économique.
À vous, lecteurs, de tirer les leçons : la courbe de Phillips n’est pas morte, elle a simplement évolué. Elle continue d’éclairer la façon dont les décideurs arbitrent entre croissance, stabilité des prix et emploi.
Courbe de Phillips : l’évolution de l’inflation et du chômage
La courbe de Phillips retrace une fresque passionnante entre théorie économique, histoire et réalité contemporaine. Elle reste pertinente à condition d’en comprendre les limites et les évolutions. Inflation et chômage ne seront jamais totalement déconnectés, mais leur relation est bien plus subtile qu’en 1958.